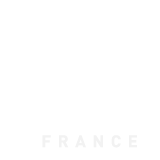Le dernier rapport de l’Insee, publié le 7 juillet 2025, confirme le renforcement d’une tendance inquiétante : la pauvreté atteint un niveau inédit depuis près de trois décennies. Au-delà de cette sécheresse statistique, c’est l’enracinement d’un échec collectif, politique et institutionnel, qui est acté.
En 2023, 9,8 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté monétaire en France métropolitaine, soit plus de 650 000 personnes supplémentaires par rapport à l’année précédente. Un chiffre déjà massif, qui grimpe à environ 12 millions si l’on y ajoute les populations invisibilisées par la méthodologie de l’enquête – habitants d’outre-mer, personnes sans-abri, personnes en institution. Ce sont les familles monoparentales (+2,9 points), les enfants (21,9 % en situation de pauvreté), les chômeurs (36,1 %) et les jeunes qui paient le prix fort de cette augmentation.
Une pauvreté qui se densifie, même en période de croissance
Contrairement aux logiques d’ajustement dominantes, cette progression est d’autant plus préoccupante qu’elle se produit dans un contexte de croissance économique, certes modeste, mais réelle, et d’un taux de chômage globalement maîtrisé. Ce paradoxe n’en est pas un : il reflète la déconnexion croissante entre emploi et sécurité économique, en dépit du dogme gouvernemental. L’emploi est en effet devenu un facteur de vulnérabilité pour une partie croissante de la population : temps partiel subis, prolifération des contrats courts, recours massif au micro-entrepreneuriat, ont rendu possible l’essor d’un phénomène que la France peine à nommer : le travailleur pauvre. Sortir du chômage ne suffit plus à sortir de la pauvreté. Pire encore, l’emploi peut devenir une trappe à précarité (consulter l’article d’EAPN France : Pourquoi la baisse du chômage n’a-t-elle pas réduit la pauvreté ?).
A cela s’ajoute le refus de revaloriser les prestations à hauteur du seuil de pauvreté, la volonté de conditionner toujours davantage les aides, les mesures de contrôle et de sanctions à l’égard des allocataires du RSA ou encore la réduction des crédits à l’aide alimentaire, qui illustrent un choix assumé : faire des personnes les plus pauvres les variables d’ajustement des politiques budgétaires.
Des inégalités qui se creusent
La paupérisation ne va pas seule : elle s’accompagne d’un enrichissement des populations les plus aisées. Tandis que les 10 % les plus pauvres ont vu leur niveau de vie baisser, celui des 10 % les plus riches a continué d’augmenter, accentuant des écarts de revenus que l’Insee juge comparables à ceux des années 1970. Une injustice d’autant plus grave qu’elle pourrait entraîner d’autres conséquences dramatiques, car il ne faut pas oublier que les inégalités sont le terreau des régimes autoritaires qui exploitent ces souffrances pour rallier des voix, comme en atteste la montée des mouvements populistes d’extrême droite lors des récentes élections à travers l’Europe.
Sortir de l’ornière : pour une stratégie systémique, ambitieuse et redistributive
Partant, EAPN France rejoint les revendications du Collectif ALERTE (consulter le communiqué d’ALERTE en cliquant ici).
- S’engager à ce que le projet de loi de finances pour 2026 protège les populations les plus pauvres de notre pays, notamment en renonçant à toute idée de gel des prestations sociales ;
- Mettre en œuvre des mesures d’urgence pour enrayer la chute dans la pauvreté d’un nombre toujours plus grand de nos concitoyens ;
- Assurer le financement des projets qui permettent le retour à un emploi durable, insertion par l’activité économique et territoires zéro chômeur de longue durée ;
- Rétablir les crédits sur l’aide alimentaire qu’il a brusquement diminué ;
- Cesser de fragiliser le secteur associatif ;
- Renoncer à ses décisions récentes qui aggraveront encore la grande pauvreté dans notre pays (loi plein emploi sur les chômeurs et allocataires du RSA, loi dite Kasbarian-Bergé sur les expulsions locatives, mesures portant atteinte aux droits des personnes en attente de régularisation).
Mais au-delà des mesures d’urgence, c’est un changement de paradigme qui s’impose. Revalorisation substantielle des minimas sociaux, lutte contre le non-recours, sécurisation des parcours professionnels, renforcement des politiques publiques locales : voilà les piliers d’un nouveau pacte social.
Enfin, les attentes sont fortes autour de la future stratégie européenne de lutte contre la pauvreté, perçue comme une opportunité majeure pour impulser une dynamique nouvelle et engager un changement de paradigme indispensable. EAPN a d’ores et déjà formulé un ensemble de recommandations ambitieuses, visant à structurer cette stratégie en cours d’élaboration, disponibles ici.
***
Il est capital de refuser une société à deux vitesses. Quand des millions de personnes voient leurs droits fondamentaux – se nourrir, se loger, se soigner, vivre dignement – traités comme des variables d’ajustement, c’est la légitimité même du contrat démocratique qui vacille. Il y a urgence à sortir de la gestion comptable du social pour renouer avec une ambition politique claire : garantir, pour toutes et tous, les conditions matérielles de l’autonomie et de la dignité.